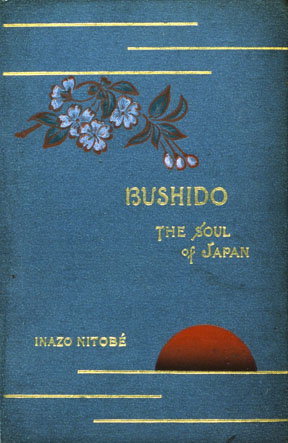Le Bushidō, l’âme du Japon
LE BUSHIDO, EN TANT QU’ÉTHIQUE
Bushidō (武士道) signifie littéralement : guerrier – seigneur – routes (ou pratiques) ; c’est-à-dire les pratiques que doivent observer les combattants nobles tant dans leur vie journalière que dans l’exercice même de leur profession.
Le bushidō est donc le code des principes moraux enseignés aux chevaliers et qu’ils étaient tenus d’observer. Ce n’est pas un code écrit ; il consiste surtout en certaines maximes — ou transmises oralement ou transcrites par la plume — formulées par quelque guerrier fameux ou par quelque savant célèbre. Le plus souvent, c’est un code qui, n’étant ni énoncé ni écrit, bénéficie d’autant plus de cette consécration puissante que confèrent à la fois le fait réel et la loi gravée dans les fibres mêmes du cœur. Ce code n’a pas été fondé sur une création issue d’un cerveau, si capable fût-il, ou sur la vie d’un seul personnage, quelque renommée qu’il ait eue. Ce fut le développement organique, pendant des décades et des siècles, de carrières militaires.
Lorsque, au Japon comme en Europe, la féodalité fut formellement inaugurée, la classe des guerriers de profession fut naturellement portée au premier plan. On les appela « samourai » (侍), ce qui veut dire littéralement, — comme le vieux mot anglais cniht (knecht, knight, chevalier), — gardes ou suivants.
Un terme sinojaponais: buke (武家) ou bushi (武士) (chevaliers combattants), fut aussi adopté pour l’usage courant.
La classe militaire au Japon était exclusivement composée de samourai, qui comprenaient à peu près deux millions d’âmes. Au-dessus d’eux, étaient les militaires nobles, les daimyō (大名), et les nobles de Cour, les kuge (公家),— ces derniers, d’une classe aristocratique plus élevée, n’étant que des sybarites et n’ayant, du soldat, que le nom. Au-dessous d’eux, était la masse du peuple : artisans de la mécanique, marchands et paysans, dont la vie était vouée aux travaux de la paix.
Comme ils en arrivaient à prétendre à de grands honneurs et à de grands privilèges, et qu’ils devaient, corrélativement, assumer de grandes responsabilités, les samourai sentirent le besoin d’une règle commune de conduite, d’autant plus nécessaire qu’ils étaient constamment sur le pied de guerre et qu’ils appartenaient à des clans différents. De même que, par courtoisie professionnelle, les médecins imposent des limites à la concurrence qu’ils se font ; de même que les hommes de loi s’en remettent à un tribunal d’honneur en cas de violation d’étiquette : de même les guerriers doivent avoir le moyen de recourir à un jugement suprême contre leurs infractions.
LES SOURCES DU BUSHIDO
Au Japon, le Bushidō eut plusieurs sources. Je commencerai par le Bouddhisme. Il procura un sentiment de confiance calme dans le destin, la soumission tranquille à l’inévitable, le sang-froid stoïque en face du danger ou du malheur, ce dédain de la vie et cet accueil amical de la mort.
Ce que le Bouddhisme ne sut pas donner, le Shintoïsme l’offrit en abondance. Le loyalisme envers le souverain, la vénération de la mémoire des ancêtres et la piété filiale : les doctrines de Shinto inculquaient tout cela plus rigoureusement que ne l’enseignait aucune autre croyance, communiquant d’ailleurs au caractère du samourai une certaine passivité, et tempérant ainsi son arrogance.
En ce qui concerne les doctrines relevant expressément de l’éthique, les enseignements de Confucius furent la source la plus abondante du bushidō.
Le caractère calme, affable et humainement sage de ses préceptes éthico-politiques était particulièrement bien adapté aux samourai, qui formaient la classe gouvernante. Ce qu’il y avait d’aristocratique et de conservateur dans le ton du Confucianisme, s’adaptait également bien à ce qui convenait à ces hommes d’État guerriers.
Après Confucius, Mencius exerça une immense autorité sur le bushidō. Ses théories énergiques — et souvent tout à fait démocratiques, — avaient une très grande prise sur les natures douées d’une sensibilité vive; et, elles furent même tenues pour dangereuses et subversives pour l’ordre social existant, ce qui fit que ses œuvres furent longtemps censurées.
Le bushidō faisait peu de cas du savoir en lui-même : il ne devait pas être recherché comme une fin en soi, mais comme un moyen d’atteindre à la sagesse.
RECTITUDE OU JUSTICE
La rectitude, ou justice, est le plus puissant précepte du code du samourai. Rien ne lui répugne davantage que les procédés sournois et les entreprises tortueuses.
Un Bushi célèbre la définit comme un pouvoir de se résoudre à quelque chose : « La Rectitude est le pouvoir de prendre, sans faiblir, une décision relativement à une certaine manière de se conduire qui se trouve conforme à la raison : de mourir quand il est bien de mourir, de frapper quand il est bien de frapper. »
Même aux derniers jours de la féodalité, alors qu’une ère prolongée de paix avait apporté à la classe guerrière une vie de désœuvrement et, avec elle, toutes sortes d’habitudes de dissipation et la pratique des arts d’agrément, l’épithète gishi (義士) (homme de rectitude) était regardée comme supérieure à tout titre exprimant la maîtrise dans la Science ou les Arts. Les Quarante-Sept Fidèles, — qui tiennent une si grande place dans notre éducation populaire, — sont connus dans le langage courant sous le nom des Quarante-Sept Gishi.
LE COURAGE
Le courage était à peine regardé comme digne de figurer parmi les vertus, à moins qu’il ne fût mis au service de la justice. Dans ses Analectes , Confucius définit le courage en montrant, comme il le faisait souvent, ce qui résultait de son absence : « Sachant ce qui est juste, dit-il, et ne le faisant pas, démontre l’absence de courage ». Replaçons cette maxime dans son sens positif, et nous aurons : « Le courage est de faire ce qui est juste ».
LA BONTÉ
L’amour, la magnanimité, l’affection pour le prochain, la sympathie et la pitié ont toujours été proclamés les vertus suprêmes, les attributs les plus élevés de l’âme humaine.
Nous savions que la bonté était une tendre vertu, proprement maternelle. Si la stricte Rectitude et l’austère Justice étaient expressément masculines, la Miséricorde avait la douceur et la force persuasive de la nature féminine. Nous étions mis en garde contre la tendance à se laisser aller à une charité sans discernement ou sans assaisonnement d’un peu de justice et de rectitude. Masamuné a fort bien exprimé la nuance dans son aphorisme souvent cité : « Rectitude poussée à l’excès se mue en dureté ; bonté pratiquée sans mesure dégénère en faiblesse ».
Heureusement que la miséricorde n’était pas aussi rare qu’elle est belle, car il est universellement vrai que : « les plus braves sont les plus tendres et que ceux qui aiment sont ceux qui osent ». Bushi no nasake (武士の情け) — la tendresse d’un soldat — : ces mots rendaient un son qui éveillait tout de suite en nous je ne sais quoi de noble ; non pas que la pitié d’un samourai fût spécifiquement différente de celle d’une autre créature humaine, mais parce que cette tendresse-là impliquait une sorte de pitié, qui n’était pas seulement un pur réflexe de l’instinct : on y discernait un hommage conscient à la justice ; la pitié n’y était pas seulement un simple état de la sensibilité, mais elle y était renforcée par le pouvoir de tuer et de sauver.
La bonté envers les faibles, les gens à terre ou les vaincus, fut toujours exaltée comme convenant particulièrement à un samourai.
LA POLITESSE
La politesse n’est qu’une assez piètre vertu si elle est inspirée uniquement par la crainte d’offenser le bon ton, attendu qu’elle devrait être surtout la façon extérieure de manifester des égards sympathiques pour les sentiments d’autrui. Elle implique aussi le respect que l’on doit à des convenances justifiées.
Dans sa forme la plus haute, la politesse confine presque à l’amour. Nous pouvons donc dire avec respect : la politesse « est très patiente et elle est bonne ; elle n’envie point, elle ne se vante pas, ne fait pas d’embarras ; elle ne se comporte pas d’une façon inconvenante, ne pense pas à elle-même, n’est pas facilement vexée et ne fait pas attention au mal ».
Quand elle ne ferait pas autre chose que de conférer de la grâce aux manières, la politesse serait déjà une précieuse acquisition ; mais son rôle ne s’arrête pas là. Car la bienséance étant due, en fait, à des mobiles de bonté et de modestie, et étant inspirée par de tendres sentiments pour les sensibilités des autres, est toujours une façon gracieuse d’exprimer sa sympathie.
VÉRACITÉ ET SINCÉRITÉ
Sans véracité et sans sincérité, la politesse n’est que farce et semblant. « La bienséance poussée à l’extrême, dit Masamuné, devient un mensonge ».
Mensonge ou équivoque étaient tenus pour une lâcheté égale. Le bushi soutenait que sa haute position sociale réclamait une véracité d’un degré supérieur à celle d’un commerçant ou d’un paysan. Bushi no ichigon (武士の一言), c’est-à-dire la parole donnée par un samourai, était une garantie suffisante de la véracité d’une assertion. On a raconté des anecdotes saisissantes sur ceux qui expièrent par la mort le nigon (二言), une langue double.
Sacrifier la vérité uniquement par respect de la politesse était considéré comme une « forme vide » (kyorei 虚礼) et une « tromperie par de douces paroles ».
L’HONNEUR
Le sentiment de l’honneur, impliquant une conscience très aiguë de valeur et de la dignité personnelles, ne pouvait manquer de devenir la caractéristique des samourai, nés et élevés dans l’estime des devoirs et des privilèges de leur profession.
Quoique le mot ordinairement employé de nos jours pour exprimer l’idée d’honneur ne fût pas couramment employé, l’idée cependant en était traduite par des termes tels que : na (名) (nom), menmoku (面目) (contenance), gaibun (外聞) (attention extérieure), tous termes qui, respectivement, évoquent pour nous la « réputation ». Un bon nom, c’est-à-dire la réputation que l’on a, posait comme chose allant de soi que toute atteinte à l’intégrité de ce nom était considérée comme une honte ; et le sentiment de la honte (renchishin 廉恥心) était, dans l’éducation de la jeunesse, un des premiers à cultiver.
LE DEVOIR DE FIDÉLITÉ
Au nombre des causes en comparaison desquelles la vie ne méritait pas qu’on y tînt, était le devoir de fidélité, — clé de voûte qui faisait des vertus féodales une arche aux courbes pures.
La moralité féodale a, avec d’autres systèmes d’éthique, avec d’autres classes du peuple, encore bien des vertus qui leur sont communes ; mais cette vertu — hommage et loyalisme à un supérieur — est son trait caractéristique.
Le Bushidō n’exige pas que nous rendions notre conscience l’esclave de n’importe quel maître ou roi. Un homme qui sacrifiait sa conscience à la volonté capricieuse, aux lubies, aux fantaisies d’un souverain, était tenu en piètre estime dans les Préceptes. Il était méprisé comme neishin (佞臣), comme un être rampant qui fait sa cour par de peu scrupuleuses flagorneries, ou comme chōshin
(寵臣), comme un favori qui vole l’affection de son Maître par de serviles complaisances.
L’EDUCATION ET LE DRESSAGE D’UN SAMOURAI
Le premier point à observer dans la pédagogie de la chevalerie était de former le caractère en laissant dans l’ombre les facultés plus artificieuses de prudence, d’intelligence et de dialectique.
La supériorité intellectuelle était, certes, estimée ; mais le mot chi (知) qui était employé pour désigner l’intellectualité, voulait dire, en premier lieu, sagesse, et n’accordait à la science qu’une place très subordonnée.
Le trépied qui supportait la charpente de Bushidō fut appelé chi (知), jin (仁), yū (勇), respectivement: sagesse, bonté, courage.
LE CONTRÔLE DE SOI
Le contrôle de soi-même, discipline des disciplines, était universellement requis d’un samourai.
D’un côté, discipline de la force d’âme ; de l’autre, enseignement de la politesse nous invitant à épargner aux autres le spectacle de notre tristesse et de nos souffrances pour ne pas gâter leur plaisir ou troubler leur sérénité : ces deux éléments se combinent : d’une part, pour engendrer dans l’individu un état d’âme stoïque ; et, d’autre part, pour se préciser, avec le temps, en un trait de caractère commun à la nation : un stoïcisme apparent.
Pour un samourai, de laisser ses émotions se trahir sur son visage était considéré comme un manque de virilité. « Il ne montre aucun signe de joie ou de colère » était la phrase usitée pour dépeindre un grand caractère. On se devait de dominer ses affections les plus naturelles.
La discipline dans le contrôle de soi-même peut facilement tomber dans l’exagération. Si noble que soit une vertu, elle a toujours sa contre-partie et sa contre-façon. Dans chaque vertu, il faut savoir discerner ce que son excellence a de positif, et poursuivre l’objet positif de son idéal ; et l’idéal de la maîtrise de soi c’est de garder l’équilibre de l’esprit.
Le contrôle de soi-même atteint son maximum et son apogée dans l’institution du suicide.
LES INSTITUTIONS DU SUICIDE ET DE LA RÉPARATION DES TORTS
Pour commencer par le suicide, je dois dire que je bornerai mes observations au seul seppuku (切腹) ou kappuku (割腹), connu sous le nom populaire de harakiri (腹切り), qui signifie immolation de soi-même en s’ouvrant les entrailles.
Le choix de cette partie spéciale du corps pour une telle opération était basée sur une ancienne croyance anatomique qui prévalait parmi les Japonais que l’abdomen renfermait l’âme. Cette notion de psychologie physiologique une fois acceptée, le syllogisme de seppuku est facile à construire. « J’ouvrirai la demeure de mon âme et vous la ferai voir telle qu’elle est. Voyez vous-même si elle est souillée ou pure ».
Seppuku n’était pas une simple pratique de suicide. C’était une institution légale et rituelle. Invention du Moyen-Age, c’était une pratique grâce à laquelle les guerriers pouvaient expier leurs crimes, s’excuser de leurs erreurs, échapper au déshonneur, racheter leurs amis, ou prouver leur sincérité. Lorsque ordonné comme punition légale, il était pratiqué en grande cérémonie. C’était une épuration de l’acte de se détruire et personne n’eût pu l’accomplir sans le plus grand sang-froid et sans commander à tout son être ; et, pour ces raisons, il convenait particulièrement à la profession de bushi.
Dans la réparation — ou la revanche, si vous voulez —, il y a quelque chose qui satisfait notre sentiment de la justice.
Notre sentiment de la revanche est aussi précis que notre sens des mathématiques, et, tant que les deux termes de l’équation ne sont pas égaux, nous sentons qu’il y a quelque chose qui est resté en souffrance. Cette logique est simple et enfantine ; néanmoins, elle démontre un sens inné de l’équilibre et de la justice. « Œil pour œil, dent pour dent. »
Quoique Lao-Tsé eût enseigné le pardon des injures, la voix de Confucius fut beaucoup plus forte, qui enseignait qu’il était juste de punir; et cependant la revanche n’était justifiée que si elle était entreprise pour venger nos supérieurs ou nos bienfaiteurs. Les injures personnelles, y compris celles faites à notre femme et à nos enfants, devaient être supportées et pardonnées.
Les deux institutions du suicide et du redressement perdirent leur raison d’être à partir de la promulgation du Code criminel.
LE SABRE : AME DU SAMOURAI
Le Bushidō fit du sabre l’emblème de sa puissance et de ses prouesses.
De très bonne heure, le samourai en apprenait le maniement. Ce que le samourai porte à sa ceinture est le symbole de ce qu’il porte dans son esprit et dans son cœur : loyalisme et honneur.
Les deux sabres, — le plus long et le plus court, — appelés respectivement daitō (太刀) et shōtō (小刀) ou katana (刀) et wakizashi (脇差) ne quittent jamais son côté.
L’ÉDUCATION ET LA CONDITION DE LA FEMME
Le bushidō appréciait les femmes « qui s’affranchissaient des faiblesses de leur sexe, et qui déployaient un courage héroïque digne des hommes les plus forts et les plus braves ». Les jeunes filles étaient donc élevées à réprimer leurs sentiments, à fortifier leurs nerfs, à manier les armes — spécialement le sabre à longue poignée appelé naginata (薙刀) — pour être à même de se défendre dans des conjonctures imprévues.
Il va de soi que le but primitif de cette éducation martiale n’était pas le champ de bataille; elle avait à la fois une fin d’ordre individuel et d’ordre domestique. La femme, n’ayant pas de suzerain personnel, s’instituait son propre garde du corps. Avec son arme, elle défendait son propre honneur avec autant de zèle que son mari celui de son maître. Quant à l’utilité domestique de son éducation guerrière, c’était de la rendre apte à l’éducation de ses fils.
Les jeunes filles, quand elles atteignaient l’âge de femme, étaient dotées de poignards kaiken (懐剣) (poignards de poche) dont elles pouvaient menacer la poitrine de leurs assaillants, ou que, le cas échéant, elles pouvaient tourner contre leur propre sein.
Les femmes étaient élevées pour la vie de famille. On peut dire que les arts d’agréments des femmes du Vieux Japon, qu’ils eussent un caractère martial ou pacifique, avaient principalement en vue le foyer ; et, si loin de cet objet que l’on se laissât parfois entraîner, jamais on ne perdait de vue que, le foyer, c’était le centre. C’est pour maintenir l’intégrité et l’honneur de ce foyer qu’elles travaillaient sans relâche, qu’elles peinaient et sacrifiaient leur vie. Comme fille, la femme se sacrifiait pour son père; comme femme, pour son mari ; comme mère, pour son fils. Ainsi, dès sa prime jeunesse, elle était instruite au renoncement.
Référence
Le Bushidō, l’âme du Japon, Inazo Nitobe, Traduction française de Charles Jacob, Paris, 1927.
Résumé rédigé par Christophe Delmotte – International Kyokushin Organization Tezuka Group – 2021